Une esquisse du monde de demain
La méthode Trump : décryptage d’un art de la négociation disruptive
En affaires comme en politique, Donald Trump a imposé une méthode de négociation radicale, fondée sur le rapport de force, l’imprévisibilité et la communication stratégique. Son approche, qualifiée de transactionnelle, bouscule les codes traditionnels de la diplomatie et des relations internationales. Que l’on adhère ou non à son style, il est indéniable que cette stratégie d’influence a laissé une empreinte durable sur la scène mondiale.
Alors, quelles sont les clés de la négociation selon Trump ? Quels enseignements peut-on en tirer pour comprendre les dynamiques géopolitiques et les mécanismes de pouvoir ?

Une approche transactionnelle : la négociation comme un deal avant tout
La vision marchande du pouvoir : Donald Trump a toujours perçu la politique étrangère comme une extension du business. Pour lui, un bon accord repose sur un bénéfice immédiat et tangible pour son camp, sans considération pour les engagements à long terme.
Cette approche a conduit à :
- La renégociation ou le retrait des accords jugés défavorables (ex : ALENA remplacé par l’USMCA, accord de Paris sur le climat, accord sur le nucléaire iranien) ;
- Une vision de la puissance fondée sur le coût-bénéfice, où les alliances traditionnelles sont subordonnées aux intérêts économiques immédiats.
Le rapport de force permanent : L’une des caractéristiques majeures de la stratégie de négociation de Trump est l’usage du rapport de force. Cette approche repose sur :
- Des menaces tarifaires et sanctions économiques comme leviers de pression (ex : guerre commerciale avec la Chine) ;
- Une stratégie du bluff et de l’escalade contrôlée, particulièrement visible dans les négociations avec la Corée du Nord ;
- Un style de négociation maximaliste, visant à obtenir un avantage décisif avant toute concession.
Cette posture, souvent perçue comme agressive et imprévisible, a néanmoins permis à Trump d’imposer son rythme dans plusieurs dossiers clés de la géopolitique mondiale.
Une communication offensive : la négociation par le storytelling
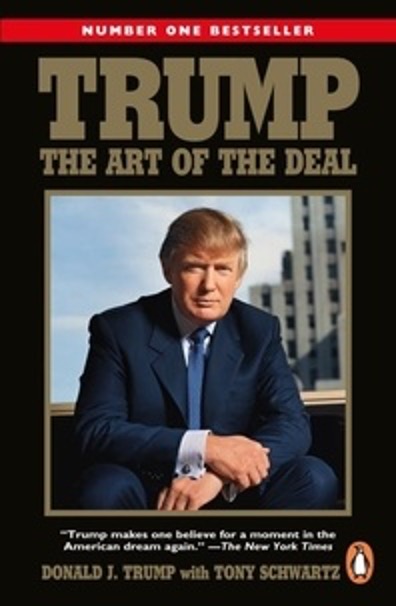
La force du narratif et du branding personnel : Trump a su faire de sa communication un outil de négociation à part entière. Il a bâti une image de leader dur et imprévisible, capable de déstabiliser ses adversaires.
Sa stratégie repose sur :
- La simplification des enjeux par des formules percutantes : America First, bad deals, winning big ;
- La mise en scène de sa rupture avec l’establishment et des institutions traditionnelles ;
- Une utilisation habile des réseaux sociaux et des médias pour imposer son agenda politique.
La gestion du tempo médiatique : Trump a révolutionné l’usage du tempo médiatique en négociation. Plutôt que de suivre les canaux diplomatiques classiques, il a privilégié :
- L’escalade verbale suivie de volte-face tactiques (ex : correspondance avec Kim Jong-un, alternance entre menace et flatterie) ;
- L’annonce de décisions choc via Twitter, forçant ses interlocuteurs à réagir sur son terrain ;
- Une mise en scène permanente de ses succès diplomatiques, même lorsque les avancées étaient minimes.

Cette capacité à maîtriser le narratif lui a permis d’exercer une pression psychologique constante sur ses adversaires, en les obligeant à réagir à son rythme.
Une diplomatie transactionnelle : l’adaptation pragmatique aux rapports de force

La personnalisation des relations internationales : Trump a privilégié une diplomatie bilatérale fondée sur des relations directes avec les dirigeants, parfois au détriment des institutions multilatérales.
Exemples marquants :
- Ses relations avec des leaders autoritaires comme Poutine, Bolsonaro ou Kim Jong-un ;
- Une dévalorisation des alliances traditionnelles comme l’OTAN ou l’Union européenne ;
- Une approche pragmatique où la personnalité du dirigeant compte plus que les institutions.
Cette méthode a permis des avancées rapides dans certains dossiers, mais a aussi fragilisé des équilibres diplomatiques de long terme.
La remise en cause des normes diplomatiques : Trump a constamment cherché à redéfinir les règles du jeu, en bousculant les pratiques établies :
- Retrait unilatéral de plusieurs accords internationaux (ex : Accord de Paris, accord iranien, TPP) ;
- Contournement des canaux diplomatiques traditionnels, privilégiant une approche médiatisée et spectaculaire ;
- Stratégie du chaos, où l’incertitude devient une arme pour forcer les adversaires à s’adapter.
Résultats et limites : efficacité ou instabilité ?

Des succès tactiques dans des négociations ciblées : L’approche de Trump a produit des résultats concrets :
- La renégociation de l’ALENA en USMCA, considéré comme plus favorable aux Etats-Unis ;
- Une remise en question des déséquilibres commerciaux avec la Chine, via une politique de sanctions ,
- Une mise en scène de succès diplomatiques, notamment avec la Corée du Nord (malgré des résultats limités sur le long terme).
Les risques d’une approche trop disruptive : Cependant, cette méthode ultra-agressive a aussi des effets pervers :
- Une perte de crédibilité auprès des alliés, notamment en Europe et en Asie ;
- Une montée des incertitudes géopolitiques, avec des accords instables et une absence de vision stratégique à long terme ;
- Une fragilisation des institutions multilatérales, laissant plus de place à la montée des puissances rivales.
L’héritage diplomatique de Trump reste donc contrasté : efficace sur certains dossiers, mais porteur d’un risque d’instabilité durable.
La tactique du « chat mort » : détourner l’attention pour dominer la négociation

Parmi les nombreuses stratégies utilisées par Donald Trump dans ses négociations, la tactique du « chat mort sur la table » mérite une attention particulière. Popularisée par Lynton Crosby, stratège politique australien, cette technique consiste à introduire un sujet choc, polémique ou émotionnellement fort afin de détourner l’attention de son interlocuteur et reprendre le contrôle du débat. Trump, comme Boris Johnson, a régulièrement employé cette méthode, aussi bien dans la sphère politique que dans ses négociations internationales.
Principe de la tactique du chat mort : L’idée centrale de cette stratégie repose sur une image frappante :
- « Si vous placez un chat mort sur la table pendant un dîner, tout le monde cessera de parler de ce qui était en discussion et se concentrera sur ce chat mort. »
En d’autres termes, il s’agit d’introduire un élément perturbateur qui dévie l’attention des enjeux fondamentaux et force les acteurs en présence à réagir à ce nouveau sujet. Cette technique est particulièrement efficace pour :
✅ Faire diversion lorsque l’on est en position de faiblesse dans une négociation ;
✅ Redéfinir l’agenda en imposant ses propres priorités ;
✅ Déstabiliser l’adversaire en l’obligeant à répondre à un sujet qu’il n’avait pas anticipé ;
✅ Mobiliser l’opinion publique sur une controverse afin de créer une pression externe sur les négociateurs.
Trump et l’usage du « chat mort » en négociation : Donald Trump a utilisé cette tactique à plusieurs reprises dans ses échanges avec ses adversaires politiques et dans ses négociations internationales.
🔴 Exemple 1 : Guerre commerciale avec la Chine
Lors des tensions commerciales avec Pékin, Trump a régulièrement utilisé des accusations médiatiques tonitruantes (vol de propriété intellectuelle, manipulations monétaires, accusations sur la gestion du COVID-19) pour détourner l’attention des négociations tarifaires en cours. Résultat ? Les discussions économiques étaient reléguées au second plan, tandis que la pression médiatique et politique sur la Chine augmentait ;
🔴 Exemple 2 : Tensions avec l’Union Européenne
Lorsque Trump voulait renégocier les termes de certains accords commerciaux avec l’UE, il n’hésitait pas à menacer publiquement d’augmenter les taxes sur les importations de voitures européennes ou à qualifier certains pays de « profiteurs de l’OTAN ». Ces déclarations forçaient l’UE à répondre immédiatement à ces attaques, laissant Trump en position de force pour dicter ses propres conditions ;
🔴 Exemple 3 : Le golfe de l’Amérique, la chute de Trudeau, non à US steel, renvoie des Colombiens, conquérir le Groenland, le Canada 51ème état, s’emparer du Canal du Panama, faire payer les pays membres de l’Otan, faire revenir la Russie dans le G7, réduire les coûts de fonctionnement de l’État fédéral…
🔴 Exemple 4 : Politique intérieure et impeachment
Face aux différentes tentatives d’impeachment et aux enquêtes sur son administration, Trump lançait systématiquement des sujets polémiques via Twitter. Il attaquait ses opposants, lançait des controverses sur les médias, ou évoquait des théories du complot. Cette surenchère médiatique permettait de dissoudre l’attention du public et de déplacer le débat sur un autre terrain.
Efficacité et limites de la tactique : Cette stratégie a permis à Trump de maîtriser l’agenda médiatique et de prendre l’avantage psychologique dans ses interactions. Cependant, elle présente des limites :
❌ Saturation du public : à force d’être utilisée, la technique peut perdre de son efficacité et être perçue comme une manipulation grossière ;
❌ Crédibilité en jeu : imposer trop souvent des sujets polémiques peut nuire à la réputation et à la légitimité du négociateur ;
❌ Effet boomerang : en cas d’échec, cette tactique peut se retourner contre son utilisateur, le faisant apparaître comme un acteur de mauvaise foi.
La tactique du « chat mort » illustre parfaitement la manière dont Trump utilisait la provocation, la diversion et l’escalade médiatique pour orienter les négociations à son avantage. Cette approche, bien que risquée, lui a souvent permis de prendre le contrôle du débat et d’imposer son propre agenda.
A retenir :
La méthode Trump en négociation repose sur un style transactionnel, une communication offensive et une approche disruptive des rapports de force. Si cette stratégie lui a permis d’imposer ses priorités, elle pose aussi la question de sa durabilité et de ses effets à long terme sur l’ordre mondial.
Dans un contexte où les relations internationales deviennent de plus en plus complexes, cette approche peut-elle survivre aux réalités du multilatéralisme et de la diplomatie de long terme ?

